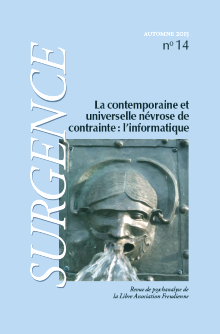Surgence n°13 : Psychanalyse de l'enfant, nouvelles perspectives
« Désormais Sans Moi » pourrait s'exclamer le jeune sujet, objet de cette psychiatrie d'inspiration américaine. Dys-qualifié, dys-orienté, dys-socié, le sujet n'est-il pas ainsi condamné à rejoindre la cohorte des exclus, sans autre habitation que celle du handicap ?
La faillite des Etats occidentaux à contenir un monde marchand qui réclame avant tout un citoyen-consommateur docile, rejaillit jusque dans l'organisation de l'éducation et des soins pour l'enfant. Ainsi s'exprime avec insistance la prévalence de l'évaluation, du résultat, de l'effi-science, le thérapeute-coacher se devant de tenir les rênes de l'attelage familial et maîtriser l'enfant.
Mais l'enfant par ses troubles continue de faire scandale: intranquillités, incompréhensions, désobéissances, mensonges ne sont que l'envers d'une conduite qu'il n'adopte pas facilement. Sigmund Freud, dès 1905, inscrit le corps de l'enfant et son organisation fonctionnelle dans une perspective érogène, saisissant qu'ainsi le jeune sujet affirme sa vitale sexualité.
Dans cette perspective n'est-il pas important de redire ce qui caractérise la démarche psychanalytique auprès de l'enfant ? Quand le corps s'en-mêle, comment l'entendre, ni le faire taire, ni en revenir au corps à corps maternant ? Que faire d'une non-demande, prise dans l'exigence des imagos parentaux ? Comment rendre compatible besoin de méconnaître et envie de savoir ?
La Libre Association Freudienne poursuit ses recherches conformément à l'éthique son fondateur Gabriel Balbo, et entend associer à ces journées, ceux qui pourraient se sentir concernés par le « moderne » sort fait à l'enfant: travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs, magistrats, soignants ...
Psychanalyse d’une forme clinique d’encoprésie chez l’enfant : une discute pour une dispute …
- Détails
- Écrit par : Aurélia BENISTY
Analyse d’un cas clinique, dans lequel il est question d’un symptôme infantile, relatif à l’encoprésie, fréquent dans la pratique : le jeune enfant qui retient ses excréments et n’accepte de les livrer que de façons originales, toujours peu hygiéniques.
Quelle est la part de la jouissance du symptôme qui revient aux parents et celle qui revient à l’enfant ?
L’enfant sublime facilement et librement sa pulsion sexuelle infantile dans le cadre de sa cure analytique. Il est à l’âge où la pulsion de savoir est en pleine expansion. Celle-ci le mène avec facilité, à chercher des réponses à ses questions, pour élaborer lui-même, sa théorie sexuelle infantile.
Quand il franchit dans la cure le point où il risque de priver ses parents de leur jouissance, les résistances des parents se font sentir. Les parents viennent alors ponctuer le travail. Leurs résistances sont à prendre en considération, tant que possible, en tant qu’elles concernent leur propre jouissance et notamment le point où ils en sont demeurés de l’élaboration de leur théorie sexuelle infantile.
L’obstacle qu’ils opposent est parfois infranchissable. Le dépasser impliquerait souvent que les parents entreprennent eux-mêmes leur propre analyse. Mais, ils souhaitent parfois, comme dans ce cas clinique, rester dans l’ignorance de ce dont se soutient leur jouissance. Ils refusent d’endosser leur part de responsabilité dans le symptôme de l’enfant.
Le jeune enfant, qui s’est civilisé au cours de la cure analytique, accepte souvent le compromis pour un laps de temps supplémentaire. Il accepte de soumettre son corps à la jouissance de ses parents, jusqu’à ce que son désir de liberté et d’indépendance ne reprenne le dessus.
Il arrive alors qu’il redemande à venir parler.
Plus qu’à l’objet, s’identifier le discours
- Détails
- Écrit par : Simon BIGORGNE
« S’identifier le discours » n’est pas s’identifier « au discours ».
Cette licence de G. Balbo et J. Bergès permet d’appréhender le phénomène identificatoire à partir du tiers terme que constitue le discours.
Ce discours permet au jeune parlêtre de s’extraire du corps à corps, du corps et du masochisme réels. En s’identifiant le discours il s’empare de signifiants, qu’il traduit et trahit pour devenir l’auteur de ses symptômes et de son inscription dans le symbolique et le social.
L’enfant (a) typique
- Détails
- Écrit par : Yves INSERRA
D’un témoignage d’une place d’analyste en pratique libérale, c’est de cela dont il s’agit, sur laquelle vient s’ajouter une clinique institutionnelle se référant à la psychanalyse. Ainsi on y trouve ce qui fait une cure d’enfant au même titre qu’une cure d’adulte, le langage, la théorie qui la nourrit, les lois, les limites et les écueils à ce que c’est que psychanalyser, soit ne rien comprendre à ce qui s’y joue vraiment, mais essayer de le théoriser d’une référence à d’autres.
Du désir, il est toujours question, que ce fut un enfant, un parent, et le symptôme qui court sous ses diverses formes, déplacement, condensation, soit métonymie, métaphore, et la lecture que chacun en fait, tente d’en faire d’une place qui est la sienne.
On en restera là
- Détails
- Écrit par : Marie-Jeanne THEVENET HIMBERLIN
Du rôle de la grand-mère maternelle phallique dans la formation de la psychose infantile et de la difficulté du pointage du signifiant dans le discours de l’enfant psychotique et de ses proches en raison de la mise en place d’une défense contre le signifiant pour le sujet.
Un-corps-orare
- Détails
- Écrit par : Patrick TOULISSE
Le scandale ne cesse pas et l'enfant d'aujourd'hui manifeste toujours dans et par son corps. Pour saisir les enjeux de ces manifestations corporelles il faut revenir à l'affirmation freudienne de 1905: l'existence d'une sexualité infantile qui constitue le plaisir à être. Dans la perspective des travaux de Lacan et de l'inscription-incision érogène du corps de l'enfant par les mots de la mère, Jean Bergès et Gabriel Balbo apporte à la Psychanalyse de l'enfant leur théorie transitiviste. Elle permet une lecture radicalement nouvelle des troubles de l'enfant et réoriente les perspectives de la tenue de la cure.
Ecris !
- Détails
- Écrit par : Anny Chastang
Ecris ! Tel est le commandement auquel l'écrivain ne saurait se soustraire, si c'est l'incessance de ce vocatif qu'il se reconnaît serf de la lettre ...
Mick Jagger c’est moi
- Détails
- Écrit par : Hélène DUCRET LACAZE
De quoi se soutient la fan d’une star du rock en attente devant une porte close ? Que faire si la porte s’ouvre ? Jouer avec les mots.