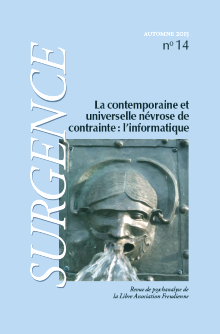Surgence n°10 : Bord, pulsion de bord, débordements
Printemps 2013
Le DSM5 est l'exemple le plus hollywoodien de ce qui peut résulter du débordement présenté comme une recension générale de la psychopathologie, Il faut dire que ce phénomène, normé ou anormal, devient peu à peu le fond des rapports des sujets et des institutions entre eux. Il en résulte une confusion des genres comme des styles. Tel que nous l'avions défini J. Bergès et moi, à propos des rapports de la fonction, du fonctionnement avec l'objet a, à propos du transitivisme par lequel l'enfant s'ordonnait par un coup de force au symbolique, le débordement ne présentait rien de confusionnel, rien de l'amalgame: les textes présentés par ce numéro montrent combien ce concept peut devenir mortifère, et combien il est fondamental d'en réduire l'extension à ce qui n'est que nécessaire.
Du diwan au divan
- Détails
- Écrit par : Patrick TOULISSE
Avant de jouer un rôle fondamental dans la cure analytique le divan venu de l’Orient y a assumé d’autres fonctions, qu’en serait-il aujourd’hui ?
Si le divan du psychanalyste est une invitation au voyage, voyage soutenu par les associations libres de l’analysant, il n’y manquera, comme dans tout voyage, ni rencontres, ni surprises, ni temps déconstruit. À ce titre l’enfant lui aussi dans sa cure ne manquera pas d’en faire son usage.
Entreprises débordées
- Détails
- Écrit par : Didier LAGAERT
Et si les concepts de fonction, fonctionnement et débordement, issus de la psychanalyse, pouvaient nous aider à comprendre ce qui se joue dans l’entreprise ? Ces mots font sens dans ces entreprises en quête de repères, où s’exprime une nouvelle forme de souffrance que l’on appelle stress, burn out.
RACI
- Détails
- Écrit par : Frédéric VITALIS
D’après G. Balbo et J. Bergès, dans la relation mère-enfant, la dysharmonie est fondamentale dans les rapports entre fonction et fonctionnement et le débordement est concerné dans tous les processus qui spécifient une fonction et son fonctionnement.
Il en est de la mère avec son enfant comme de l’entreprise – qui a aussi son discours – de façon gigogne jusqu’au niveau d’un département ou d’un service dans l’entreprise. La parabole est certes osée, le rapprochement entre la pure clinique intime du divan et l’institution est difficile, mais une lecture psychanalytique de cette dernière est possible pour mieux s’y mouvoir
Trieb-horde à tri-bords
- Détails
- Écrit par : Yves INSERRA
Brad est un petit garçon affublé d’un « diagnostique » d’obsédé sexuel, comme si la constitution même de l’enfant ne suffisait pas à en faire naturellement un pervers polymorphe. Il va accepter un travail thérapeutique qui illustre peu ou prou la théorie des pulsions, au travers de cette notion de bord, débord, abord, l’illustrant de sa recherche de la lettre au lieu même des lectures qu’il tentera à son tour de déchiffrer, décoder, décrypter sous le regard engagé de l’analyste mis au travail.
Puls(a)tion
- Détails
- Écrit par : Philippe Chaillou
Ne s’agit-il pas pour le psychanalyste d’être à cette place où, pour le sujet, il y a eu fracture, où la lettre est venue inscrire le bord afin que ce littoral, cette pulsation puisse articuler avec un peu plus de jeu le savoir et la jouissance, ce qui a un nom et ce qui n’en a pas ?
Au bord du silence
- Détails
- Écrit par : Bruno Wiard
Dans un travail de déchiffrement de la pulsion de bord, il s’agira de revisiter les oeuvres de J. Bergès et G. Balbo, S. Freud et J. Lacan en s’intéressant plus particulièrement à la pulsion, son bord et ses débordements.
Les approches conceptuelles des pulsions (et de la pulsion de mort en particulier) de ces auteurs s’enrichissent des apports mutuels entre elles mais aussi des différences qui les caractérisent.
En rester aux à bords
- Détails
- Écrit par : Marie-Jeanne THEVENET HIMBERLIN
Pour certains, trop de bord empêche de s’emparer du langage et pour d’autres pas assez de bord facilite le déplacement d’une langue à une autre, ce qui est toujours un symptôme.
Réel, bord et débordement : théorie et clinique
- Détails
- Écrit par : Gabriel BALBO
Théorie et clinique du réel chez Lacan à partir de l’injection faite à Irma de Freud.